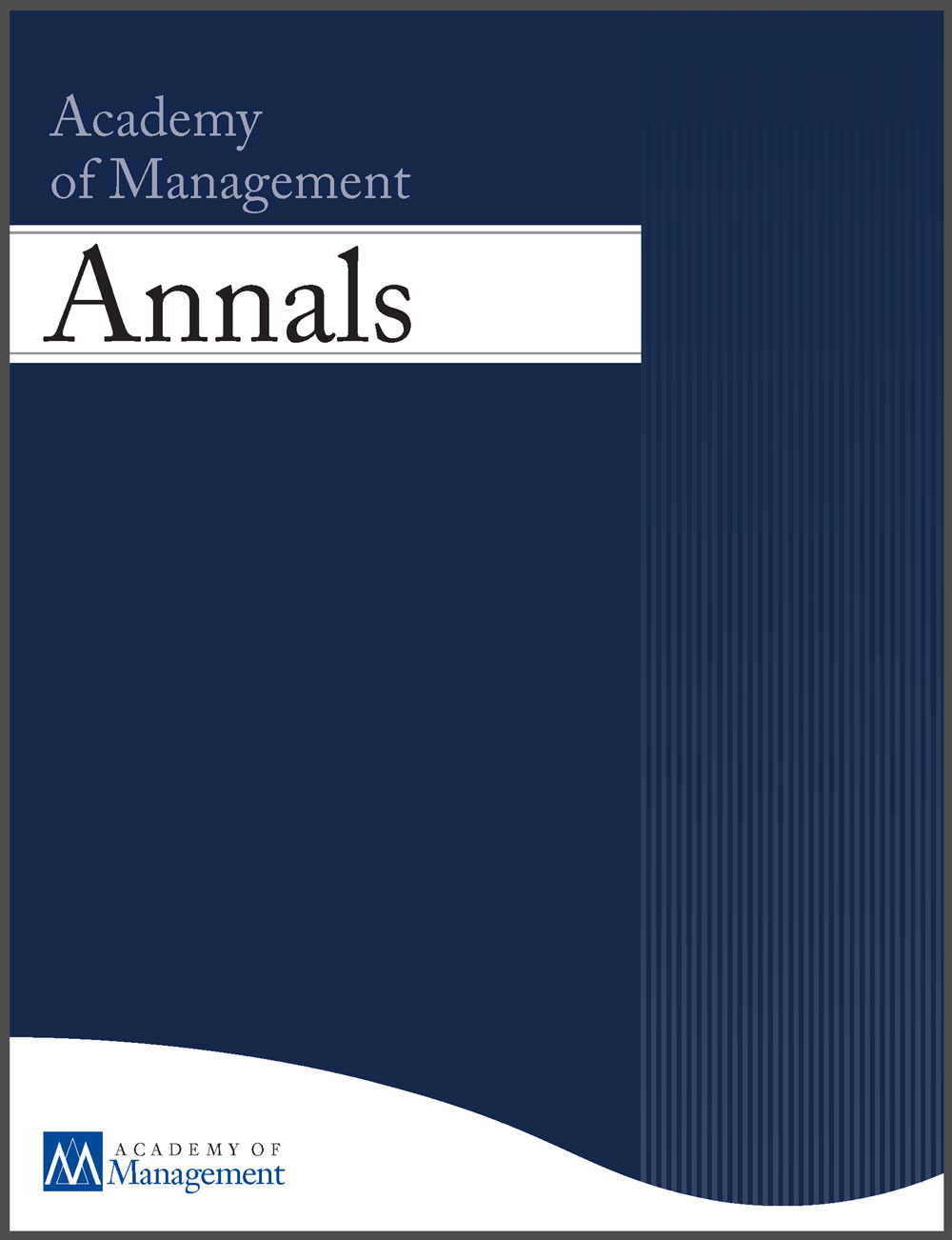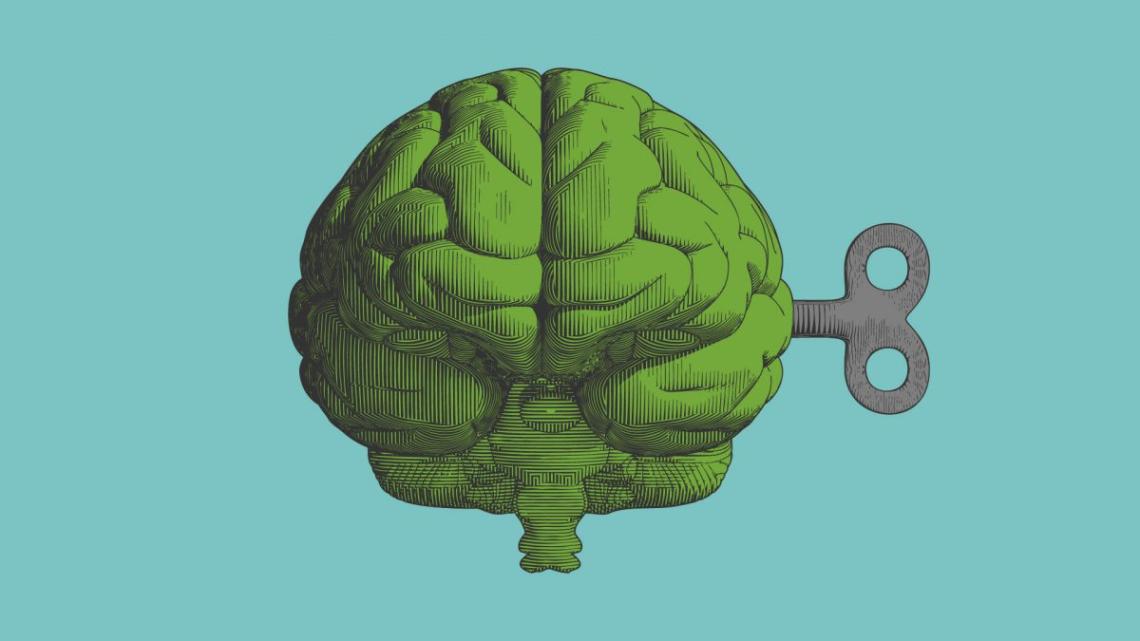Dans une tribune dans Libération, Héloïse Berkowitz (LEST – CNRS, Aix-Marseille Université) et Devi Vijay (Indian Institute of Management, Calcutta) , reviennent sur une enquête sur les organisations alternatives et la crise de nos imaginaires collectifs.
Canicules, méga-feux, méga-inondations ou méga-sécheresses, pathologies au travail, explosion de l’intelligence artificielle générative, régression des acquis sociaux, poussées fascisantes, menaces sur les libertés universitaires et de la presse. Alors que les actualités nous accablent par leur flot de catastrophes écologiques, de conflits armés, de violences sociales, et que les ultra-riches préparent la fin du monde dans leurs bunkers ou sur Mars, un sentiment persistant s’impose à nous: celui d’une impasse. Comme s’il n’existait pas d’alternative à un système qui dévore tout sur son passage et aliène chacun, des travailleurs à nos aînés jusqu’à nos enfants, et la planète elle-même, ne nous laissant que des ruines.
Et si le plus inquiétant n’était pas l’avenir qui se profile, hautement technologique, digitalisé et contrôlé par une poignée de compagnies transnationales et leurs PDG milliardaires, mais la faiblesse de l’imaginaire collectif pour y résister et cohabiter différemment ? Comme si face à cette concentration des pouvoirs et du contrôle des ressources, des infrastructures, et des forces de travail et de reproduction, dans les mains d’une poignée d’élites impérialistes, notre muscle de l’imagination avait fondu telle la calotte polaire.
Et pourtant. Les alternatives sont là. Elles prennent racine dans des formes d’organisation différentes, où le travail et les liens sociaux se réinventent depuis la solidarité, l’autonomie et le collectif. Ces alternatives prolifèrent partout, du Sud au Nord global, et dans tous les domaines de la société, de l’économie au politique, en passant par le culturel ou l’écologique. Certaines émergent dans les quartiers, d’autres créent des solidarités transnationales. Elles poussent telles ces fleurs jaillissant des craquelures du béton et des toitures.
C’est ce que donne à voir notre analyse récente, menée par une équipe internationale, de plus de 300 études dans le monde entier, sur plus de 50 ans. Coopératives, entreprises récupérées, banques de temps, monnaies locales, collectifs féministes ou écologistes, ressourceries, tontines, jardins communautaires, économie sociale et solidaire, budgets et habitats participatifs, permaculture et agroécologie: les alternatives fourmillent, partout. Tantôt aux marges, tantôt au cœur des systèmes dominants.
Ces alternatives cultivent des imaginaires pluriels et s’inscrivent dans le temps long, buissonnant sur les principes coopératifs et sur les luttes historiques féministes et queer, indigènes, anti-castes, écologistes, ou encore paysannes et des sans terres. Dans de nombreux pays du Sud Global, les sociétés postcoloniales ont porté des visions alternatives de la liberté, de la paix ou du développement. Depuis les années 1990, puis après la crise de 2008, les mouvements de solidarité, d’occupation de l’espace public - de Nuits debout aux Gilets Jaunes - ont été autant de fissures dans l’ordre dominant. Ces fissures témoignent des aspirations individuelles et collectives pour les alternatives.
Ainsi, l’Etat du Kerala, en Inde, est réputé pour le développement d’un modèle de soins palliatifs s’appuyant sur les communautés et offrant un accompagnement total - médical, social, financier et émotionnel - entièrement gratuit pour les patients et leurs familles, à rebours des grandes tendances de la privatisation des soins. En Catalogne, les communautés de pêcheurs s’organisent dans les ports avec les pouvoirs publics, les centres de recherche, la société civile dans des comités de co-gestion des pêches développant des modèles de gouvernance territorialisée qui prennent soin des humains commes des plus-qu’humains, de la seiche, au lançon, en passant par la gamba de Palamós. Au Brésil, les recuperadas sont des entreprises reprises et autogérées par les travailleurs et les travailleuses, souvent à la suite de faillites. En France, se développent les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC), ou les sociétés coopératives et participatives ou de production (SCOP), telles que la Friche de la Belle de Mai à Marseille ou SCOP-TI dans les baronnies.
« Ces initiatives prouvent que l’avenir n’est pas écrit. Des solutions existent et elles peuvent inspirer des transformations à plus grande échelle », expliquent les chercheuses.
Alors, pourquoi parle-t-on si peu de ces alternatives? Pourquoi ne sont-elles pas au cœur des récits collectifs, des politiques publiques et des débats sociétaux - sur la refonte du système des retraites, la sécurité sociale, la réindustrialisation ou la transition écologique ?
Nous vivons une crise de l’imagination. Une crise qui nous empêche de voir les autres façons de nous organiser pour rendre ce monde ne serait-ce que vivable. Aliénés par notre propre travail, malades d’une dépendance au business lucratif de la santé, nourris aux pesticides, submergés de polluants éternels, que nous buvons, respirons et portons sur notre peau: tout cela est devenu la norme. L’imaginaire dominant, caractérisé par la maximisation du profit, la compétition à tout prix, la croissance comme but ultime, l'exploitation du travail, des corps et de la planète, est présenté comme non seulement allant de soi, mais aussi comme le seul crédible.
Dans cet imaginaire uniforme et aliénant, les alternatives sont disqualifiées d’emblée: elles seraient marginales, moindres, inefficaces, irréalistes. En 2020, le président Macron opposait les défenseurs de la 5G, aux Amish et à la lampe à huile. Cette vision réductrice du « progrès » en fait un horizon unique. Les médias dominants renforcent l’invisibilisation des imaginaires alternatifs, en ne relayant que les récits des multinationales, des entrepreneurs, des start-ups, de la tech, de la consommation, réduisant encore notre capacité à imaginer. En avril chaque année se tient depuis plus de 20 ans à Brasilia le plus grand rassemblement de peuples indigènes au monde, au sein d’une alliance menant une lutte sans précédent pour la défense de leurs territoires - une résistance absente des radars médiatiques. Cette invisibilisation alimente un cercle vicieux dans nos imaginaires collectifs: ce que nous ne pouvons percevoir, nous ne pouvons ni le désirer, ni le défendre.
Pourtant, notre étude donne à voir la vitalité des organisations alternatives et leur pluralité de manières de faire monde. L’article montre comment ces multitudes d’alternatives reconfigurent les relations - de travail ou non, entre humains ou autres êtres vivants - autour de la dignité, l’équité et la solidarité. Et l’étude montre également que ces alternatives sont non seulement réalistes mais aussi urgentes face au malaise généralisé et à la dévastation du monde. Il ne s’agit plus seulement de résister, mais de construire collectivement ces formes de vie plus désirables, solidaires et vivables. Alors qu’un vote de confiance est prévu le 8 septembre et que s’organisent en France des mouvements sociaux le 10, si notre étude ne suffit pas à faire naître l’espoir, qu’elle fasse au moins germer le doute.
Tribune sur le site de Libération: "Non, il n’y a pas de crise de l’imagination : du Sud au Nord Global, des alternatives créatives et collectives existent"
L'article académique mentionné dans la tribune, intitulé "Another World is Possible, It’s Already Here: A Review and Research Agenda of Alternative Organizing" est à paraitre dans Academy of Management Annals (disponible en preprint sur HAL)